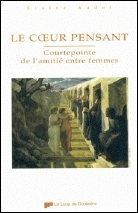Bersianik-Dworkin - Le féminisme et moipar
Louis Cornellier
D’après vous, à qui me suis-je identifié le soir du 6 décembre 1989, triste date du massacre de 14 étudiantes de l’École polytechnique par Marc Lépine ? Aux victimes, bien sûr. D’après vous, à qui me suis-je identifié le soir du 6 décembre 1989, triste date du massacre de 14 étudiantes de l’École polytechnique par Marc Lépine ? Aux victimes, bien sûr, à ces jeunes femmes qui auraient pu être mes collègues, mes soeurs, mes amies, mes amoureuses, et même... moi. Le lendemain, à l’UQAM, où j’étudiais, des affiches de groupes féministes placardées à la hâte me disaient que je ne pouvais pas, que j’étais dans l’autre camp. Ce dogmatisme, à l’époque, m’avait levé le coeur. Je me voulais, en mon âme et conscience, du côté des innocentes victimes et on me rangeait, de force, par effet de système, dans le camp des bourreaux potentiels. Peu de temps après, j’ai lu le Manifeste d’un salaud, de Roch Côté, comme une libération. Le féminisme radical avait eu raison de ma bonne foi. J’ai revécu une expérience semblable en lisant Pouvoir et violence sexiste, un recueil de textes de feue Andrea Dworkin traduits en français. Présentée par sa préfacière, Catharine A. MacKinnon, comme une géniale écrivaine martyre, combattue par les critiques, les journalistes, les éditeurs et les pornographes, cette ex-prostituée devenue « radicale, matérialiste, lesbienne, anti-raciste, femme de gauche et incarnation d’un espoir humaniste », selon les mots de son traducteur et présentateur Martin Dufresne, travaille tellement à la hache qu’elle suscite rapidement un malaise, à tout le moins pour un lecteur. Marc Lépine, écrit-elle, « n’était pas fou ». Son geste et sa pensée, assène-t-elle sans autre argumentation, « étaient politiques ». Et aux journalistes qui, comme moi, refusent d’être associés à l’assassin, elle balance : « Et il est vrai que ce ne sont pas tous les hommes qui saisissent un fusil semi-automatique. Mais beaucoup d’entre eux n’ont pas à le faire parce qu’ils ont des stylos. Beaucoup d’entre eux n’ont pas à le faire parce qu’ils ont d’autres façons d’exercer un pouvoir destructeur, annihilant sur les femmes. » Donc, faute de fusil, les hommes prennent un stylo ou autre chose, mais toujours une arme pour agresser les femmes. Une telle généralisation abusive non seulement choque, mais a aussi l’effet pervers d’exclure les hommes de la lutte féministe. J’ai passé ma vie entière à être craintif devant les violents qui sont, je le reconnais facilement, le plus souvent des hommes. J’ai toujours su, toutefois, par mon expérience intime, familiale et sociale, que le fait d’être un homme ne s’accompagne pas nécessairement du fait d’être violent. C’est la raison pour laquelle j’ai toujours considéré que le seul combat universellement valable était celui en faveur de l’humanisme, c’est-à-dire de la dignité de tous. Que ce combat ait dû prendre, souvent, et encore aujourd’hui, le visage du féminisme, va. La pleine humanité des femmes a été, ici comme ailleurs, abondamment bafouée et, dans ces conditions, le combat humaniste devait se faire féministe. Je n’accepte pas, cela dit, d’être assimilé aux méchants par réflexe dogmatique, en raison de mon appartenance au sexe masculin. Hors combat Dworkin combat avec une remarquable passion la violence faite aux femmes et toutes les discriminations dont elles sont victimes. Je partage ses propos quand elle affirme que la prostitution, sans autre forme de violence, est une violence en soi. J’y adhère encore quand elle écrit, dans une belle formule, que « le féminisme existe pour qu’aucune femme n’ait jamais à faire face à son oppresseur dans le vide, seule ». Le problème, c’est qu’elle me dit que je n’ai presque pas le droit d’y adhérer, sauf à rejeter totalement ma masculinité. Qui est l’homme qui dégrade la femme par la prostitution ? « Il est Tout le monde », répond-elle. Moi aussi, donc. Et pour être sûre de n’oublier personne, elle lance des chiffres si exagérés qu’ils en deviennent insignifiants. Ainsi, aux États-Unis, « une fillette sur trois va être agressée sexuellement avant d’atteindre dix-huit ans » et « une femme mariée sur deux est violentée ou l’a déjà été ». Des hommes bons ? Il n’y en a pas vraiment, laisse-t-elle entendre, dans une société qui célèbre le viol (!) et dans laquelle les médias « disent que la violence conjugale est vraiment sexy ». Par son radicalisme et ses outrances, Andrea Dworkin m’exclut d’un combat qui est pourtant aussi le mien. L’avenir du féminisme ne passe pas par là. Le retour de L’Euguélionne Dans L’Archéologie du futur, un recueil d’extraits tirés de cinq de ses ouvrages, l’écrivaine Louky Bersianik m’amène à me questionner sur le traitement que je réserve aux oeuvres féministes. « La question de la critique est problématique, suggère-t-elle, surtout à propos des livres écrits par des femmes. Est-ce un regard étranger que pose la critique sur des oeuvres travaillées par la conscience féministe ? En quoi consiste cette étrangeté pour le profane ? Et comment celui-ci reçoit-il la mise en question de son propre système symbolique, questionné justement par cette conscience-là ? » Ce sont, en effet, des questions essentielles, qui interdisent la naïveté critique. Dans le cas de Dworkin, je pense néanmoins avoir expliqué pourquoi elles ne suffisent pas à expliquer le malaise du lecteur. Le cas de Bersianik est différent. « Nouvel évangile, manifeste et parodie d’une extraterrestre », selon les mots de Laurent Mailhot, L’Euguélionne prêche « avec humour la bonne nouvelle », féministe, bien sûr. Si elle contient quelques affirmations qui font tiquer — « Je ne comprends pas pourquoi la Vie a si peu d’importance pour les Hommes, peut-on par exemple y lire. Probablement parce que ce ne sont pas eux qui la donnent » —, cette oeuvre propose néanmoins une intéressante réécriture mythologique et féministe de l’histoire humaine. Cultivant par moments une certaine obscurité, peut-être attribuable aux multiples analogies non expliquées avec la Grèce antique dont Bersianik serait une connaisseuse, L’Euguélionne, de même que les autres titres de l’auteure, heurte nos certitudes concernant les rapports entre le masculin et le féminin, mais il le fait, la plupart du temps, avec une habileté littéraire qui désamorce un peu les résistances. Il ne convainc pas toujours, mais il fait réfléchir. On attribue à Bersianik la maternité de la féminisation de la langue. Les propos qu’elle tient à cet égard dans L’Archéologie du futur sont, en effet, originaux et souvent justes. « Cette oeuvre, écrivait Andrée Ferretti dans Le Devoir du 24 août 2006, devrait faire la fierté de la culture québécoise. » Je ne suis pas un adepte, mais je ne dis pas le contraire. Andrea Dworkin, préface de Catharine A. MacKinnon, Pouvoir et violonce sexiste, Montréal, éditions Sisyphe, 2007, 128 pages. Louky Bersianik, préface de France Théoret, L’Archéologie du futur, Montréal, éditions Sisyphe, 2007, 144 pages. Louis Cornellier, "Le féminisme et moi", Le Devoir, 1er et 2 décembre 2007. Information sur ces deux livres. Mis en ligne le 6 novembre 2009. |



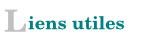
 |
« De quelle texture quelle tessiture suis-je le texte inédit
À nul autre pareil poème tissé d’infini de finitude
Dont je suis à jamais la plénitude et la limite » — Élaine Audet